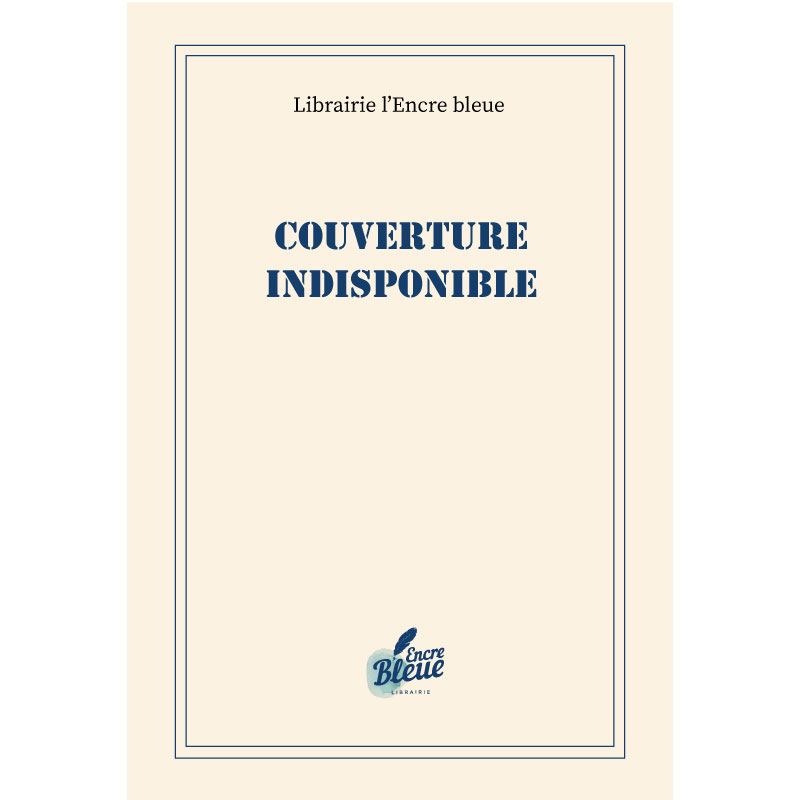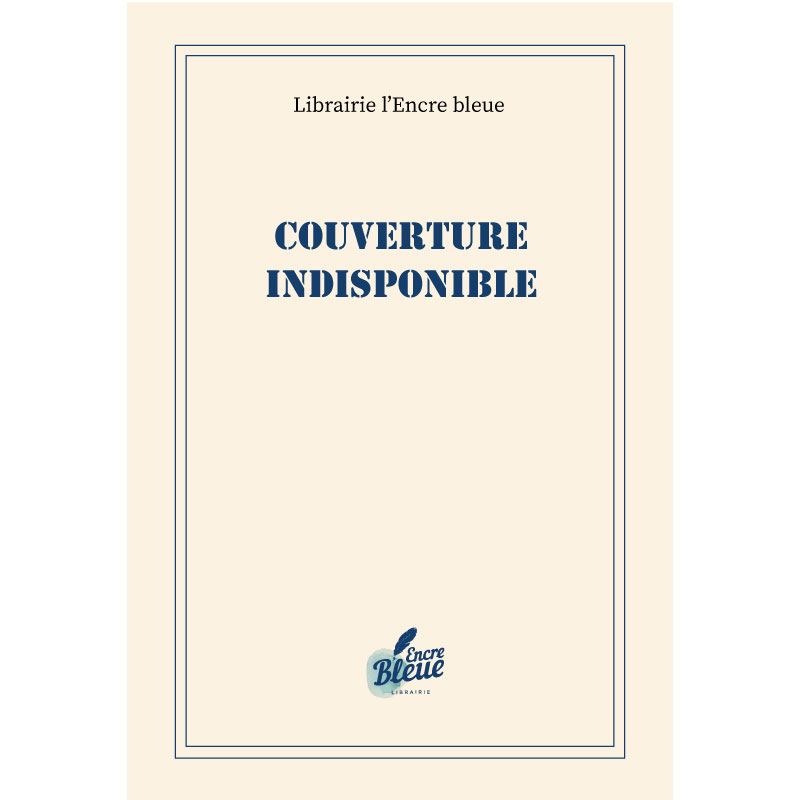R. Harre (1919-2002) s’inscrit dans la tradition de la philosophie morale britannique depuis H. Sidgwick : là où ce dernier cherchait à rendre compatibles les éléments intuitionnistes et les éléments utilitaristes de l’éthique notre contemporain s’est efforcé de réconcilier le déontologisme kantien et les considérations conséquentialistes des utilitaristes. Mais le prescriptivisme universle déveloopé à cet effet est original en ce qu’il reconnait une objectivité de la morale sans edmettre pour autant une vocation descriptive de celle-ci. C’est une analyse logique extrêmement minutieuse du langage de la morale qui permet de justifier une conculsion aussi paradoxale. Pour autant Hare n’est pas seulement un philosophe du « tournant linguistique ». Il n’a pas hésité à aborder de nombreuses questions d’éthique appliquée (dans le domaine de la bioéthique de l’environnement de l’éducation). Cet aspect de sa pensée montre de façon exemplaire à quoi peut prétendre dans le doamine pratique l’application d’une théorie constituée pour traiter des questions en apparence les plus apbstraites. Ce sont tous ces aspects d’une pensée à la fois systématique féconde et subtile que les contributions de ce volume présentent approfondissent prolongent ou critiquent.